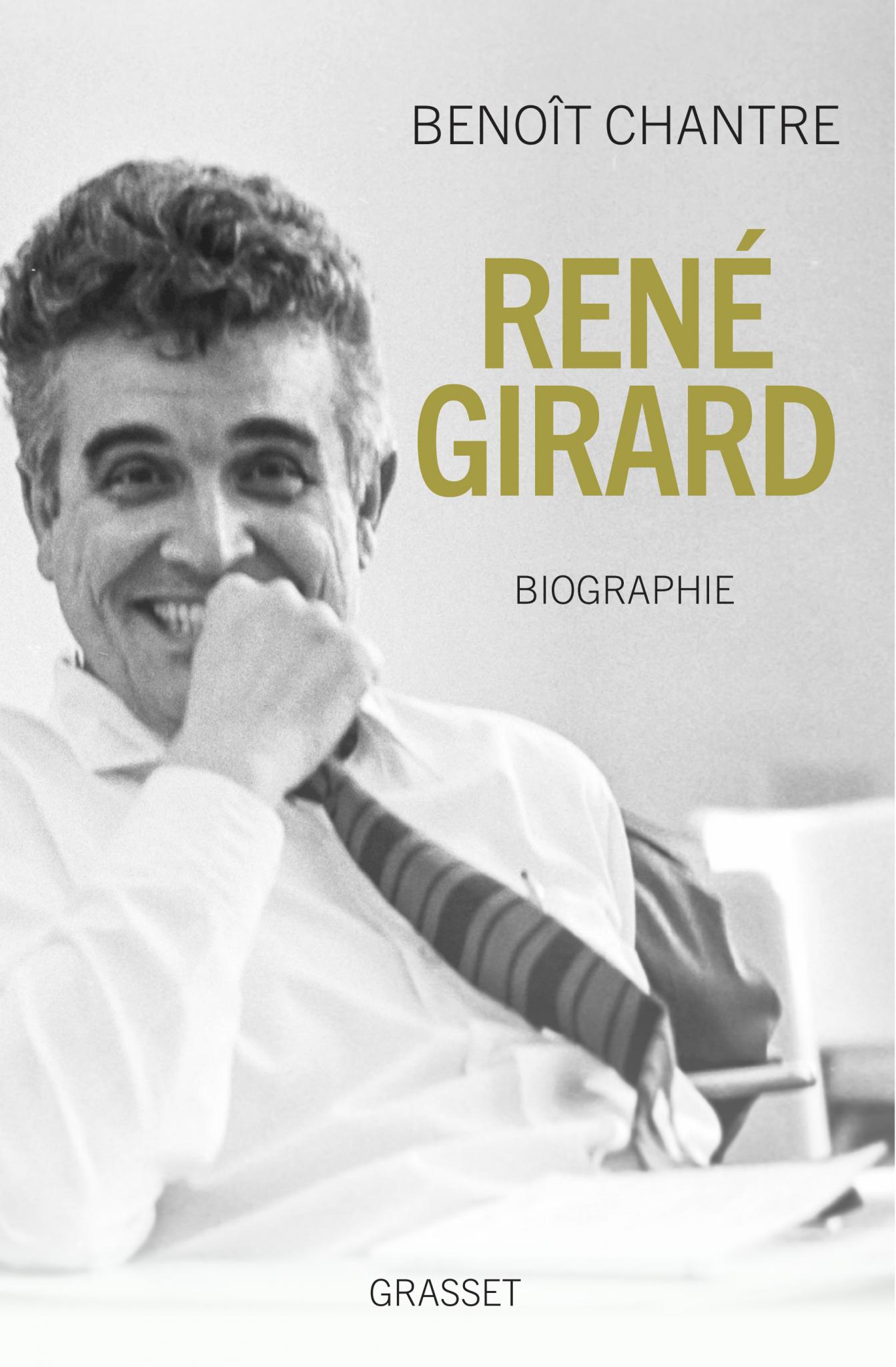Le blog de Trevor Merrill
Monday March 29
New book from Jean-Michel Oughourlian
24 octobre 2008 "Un nouveau procès kafkaïen à Prague"
Des voix s'élèvent pour défendre Kundera. BHL dans ses bloc-notes, Yasmina Réza, Slama, et aujourd'hui dans Le Monde, Pierre Nora et Krzysztof Pomanian, qui signent un article intitulé "Un nouveau procès kafkaïen à Prague": "Imaginez qu'un jour vous appreniez par voie de presse que vous êtes censé avoir commis il y a plus de cinquante ans et dont la seule "preuve" est un document trouvé dans les archives de la police politique qui sévissait à l'époque..."
Les auteurs suggèrent à Kundera "d'écrire une autre Plaisanterie, cette fois sinistre [...] Comment est-il possible qu'au nom de la lutte contre le totalitarisme on reconduise les pratiques totalitaires?" Faire de ceux qu'on accuse d'être des lyncheurs nos bouc émissaires, c'est la meilleure façon de s'aveugler sur notre propre violence, on le sait depuis longtemps déjà...
17 octobre 2008 "Sloterdijk: THEORIE DES APRES-GUERRES"
Je vous signale la parution d'un petit livre du philosophe allemand Peter Sloterdijk. Ces "remarques sur les relations franco-allemandes depuis 1945," fascinantes en soi, incluent un court chapitre sur R. Girard et son avant-dernier livre (sur Clausewitz)...
14 octobre 2008 "Kundera"
The scenario is right out of a novel by Josef Skvorecky--or (for readers of La vie est ailleurs) right out of a novel by Kundera himself. Articles in the world press (El Pais, Le Monde http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/10/13/milan-kundera-aurait-collabore-avec-la-police-secrete-communiste_1106358_3260.html) cite a report released in Prague claiming that Milan Kundera collaborated with the Czech secret police in 1950. The author has denied it, according to the same article. Pierre Assouline, on his La Republique des livres blog, has called for us to "wait" before jumping to any conclusions. Many of his readers are not so careful. I won't repeat their thoughtless words here for fear of lending them a dignity they do not deserve.
For those familiar with the mimetic theory, and its hypothesis that lynching is at the core of human culture, episodes such as this one smell fishy. Kundera was once admired as the anti-Stalinian dissident par excellence and hailed for his courage and integrity. The current accusations are all the more dubious given that the secret police of the day was adept at forging such depositions for the sake of doing just what is being done now.
Un nouveau livre de René Girard vient de sortir. Anorexie et désir mimétique (l’Herne) reprend une conférence de Girard sur les désordres alimentaires, dans laquelle il montre que l’hypothèse mimétique est capable de mordre sur le réel avec une efficacité étonnante. Super-athlètes du jeûne, les filles anorexiques refusent de manger pour devenir minces. Mais pourquoi veulent-elles perdre du poids, même au prix de leur santé ? Leur geste semble une prolongation de l’esthétique minimaliste de l’époque moderne et postmoderne. Artistes de la faim, elles opèrent sur elles-mêmes une métamorphose physique apte à prouver leur indépendance foncière, leur capacité supérieure d’ascèse. En l’absence d’une force religieuse transcendante pour régler les affaires humaines, celles-ci tendent à s’emballer vers le pire. Les filles anorexiques en sont la preuve vivante. Au sein de nos sociétés d’abondance quasi-illimitée, elles jouissent d’une liberté sans entrave. C’est cette liberté qui leur est insupportable, sans doute. Face au vide métaphysique, ces filles très masochistes, au sens mimétique du terme, s’inventent des interdits plus absolus et bien plus contraires à la vraie liberté humaine que ceux de la religion traditionnelle.
Ce petit livre propose en outre un entretien avec Girard par Mark Anspach et Laurence Tacou, ainsi qu’une préface vive et drôle du psychiatre Jean-Michel Oughourlian, et un essai introductif par Anspach qui situe le débat dans le contexte anthropologique et fournit des exemples frappants. Ces documents constituent une contribution importante à l’étude d’un des phénomènes les plus caractéristiques de notre époque.
9 mai 2008 "Je leur fiche un truc dans la figure dont ils ne soupçonnent pas la puissance"
Je suis allé à Beaubourg mercredi soir voir l’entretien filmé que Benoît Chantre a fait avec René Girard à la rentrée, juste avant le retour de ce dernier aux Etats-Unis. La projection de ce film, intitulé « Le sens de l’histoire », lance l’exposition « Les traces du sacré » au Centre Pompidou (je compte y aller, d’autant plus qu’il paraît que Achever Clausewitz et La Violence et le sacré ont été pour quelque chose dans la conception philosophique ou anthropologique de cette exposition).
Au départ, Girard n’a pas voulu faire l’entretien, nous a dit Chantre dans sa présentation du film juste avant la projection. Ayant quitté la France après la Seconde Guerre mondiale pour vivre aux Etats-Unis, ayant rompu avec le cercle surréaliste auquel il appartenait à l’époque, Girard reste, d’après l’expression d’Eric Gans, un « anti-Parisien » foncier. Or rien de plus parisien, de plus branché, et en fin de compte moins proche sur le plan spirituel et intellectuel de la théorie mimétique (dont Girard dit quelque part qu’elle « achève le christianisme »), que le Centre Pompidou, grande église de l’art contemporain français, acteur important dans cette « ritualisation de la révolution » par laquelle Girard, dans « Le sens de l’histoire », définit l’art moderne depuis Stravinsky et son Sacre du printemps.
Ce dernier représente pour lui la révélation du meurtre fondateur dans la culture moderne, c’est-à-dire une vision des choses aussi éloignée que possible de la dissimulation opérée par les mythes et prolongée dans l’humanisme occidentale, qui jette un voile pudique sur l’événement violent. « L’Adoration de la terre » est suivie, dans cette œuvre géniale qui dit la violence en langage musical et chorégraphique, du « Sacrifice » à proprement parlé, accompagné de ces accords violents et rythmés qui refusent, comme le note Girard dans l’entretien, toute joliesse. Cette « scandaleuse beauté du mal » (M. Kundera) nous fait entendre le rebours du mythe, la sauvagerie de la danse tribale sortie des abîmes de la Russie païenne. C’est l’œuvre d’un Stravinsky narquois et sardonique, nous dit Girard, qui, sur les photos prises de lui à cette époque, a l’air de dire, « je vais leur ficher un truc dans la figure dont ils ne soupçonnent pas la puissance ».
Le Centre Pompidou et les organisateurs de l’exposition « Les traces du sacré » ont fait preuve d’une ouverture admirable envers la pensée de René Girard et il faudrait les applaudir. Mais j’ai néanmoins l’impression qu'avec ce petit film de 67 minutes, Girard et Benoît Chantre nous ont fiché, à nous tous, un truc dans la figure dont nous ne soupçonnons pas encore la puissance.
17 avril 2008 "Crébillon fils"
Le roman le plus connu de Crébillon est probablement Les Egarements du cœur et de l’esprit. Madame de Lursay, la belle femme d’un certain âge à laquelle le héros doit son éducation sentimentale et sexuelle, emploie la stratégie de l’indifférence pour « ravoir » le jeune Meilcour à la fin du roman. Celui-ci, épris d’une adolescente, Hortense, veut rompre avec Madame de Lursay mais ne sait pas trop comment s’y prendre. Un soir, il se rend chez elle en espérant y trouver Hortense. Sa bien-aimée n’est pas là, mais c’est trop tard : malgré sa peur d’affronter Madame de Lursay, qu’il n’aime plus, il est obligé de rester. Rassuré d’abord par l’apparente tranquillité de sa maîtresse platonique, il se met à jouer à la roulette comme si de rien n’était. Cependant, voyant que Lursay est en train de flirter avec un autre homme, un certain Marquis, son soulagement se transforme imperceptiblement en inquiétude ; piqué, il finit par ressentir une jalousie d’autant plus vive qu’il ne s’y attendait pas du tout. Après le départ des autres invités, Madame de Lursay en profite pour le déniaiser.
A mon avis, à part peut-être Proust ou Sarraute, nul romancier français n’a décrit l’expérience subjective du désir avec autant de précision et de raffinement que Crébillon fils.
When I walked into La Hune and picked up a copy of the issue of Esprit in question, this problem was already in the back of my mind due to a series of discussions I’d been having over the preceding week with a visiting American friend, who dismisses 9/11 as a tragic but ultimately insignificant aberration, and believes that as far as the terrorist threat is concerned, the United States has only its own paranoia and misjudgment to blame for whatever disasters may befall it. From this perspective, future attacks (should they occur—a possibility my friend considers slim) could be construed as the result of a vicious circle initiated by powerful leaders whose near-sighted policies end up generating the very terrorist threats they were intended to stamp out. Though he doesn’t use the phrase himself, what he’s talking about is a self-fulfilling prophecy: by overreacting to a perceived threat, we bring the dreaded reality into being as if by magic. Our best bet (so this logic states) is to keep a cool head and avoid any sudden moves which could spook the Other and turn him into an enemy.
It’s true that in my effort to correct what I see as his excessively bullish view on things, I occasionally sound like a prophet of doom. And Bush and his neoconservative advisers undoubtedly have made the world a more dangerous place for us all. But my friend’s refusal to acknowledge the destruction of the World Trade Center as anything more than just another terrorist attack strikes me as symptomatic. 9/11 was a reminder—or perhaps a warning—that our proud Western societies were vulnerable, and that a small handful of men could use our technology against us to inflict a blow from which America may not yet have recovered. The attacks peeled back the outer layer of American confidence to reveal the fragility and fear lurking just beneath the surface of our collective psyche. It is understandable that after such a direct encounter with reality, we would be tempted to retreat back into our shell and pretend that nothing all that unusual had occurred. But events in the years since 2001 have only underscored the incredible tenuousness of the fabric of our consumer societies. The planned terrorist attacks thwarted in London in 2006 would have wreaked untold havoc, not just on international air travel, but primarily on our already frayed nerves--not to mention the massive loss of life. Yet the matter has been forgotten; not repressed, but simply allowed to dissolve into the ether where momentarily thrilling but ultimately inconsequential news stories go to die. Or perhaps this forgetting is another form of repression, a passive but all the more effective form. What Jean-Pierre Dupuy says in his Esprit article about our nuclear industry could very well be applied to our attitude about terrorism : « Ces catastrophes majeures qui n’ont pas eu lieu à un near miss près sont la seule garantie que nous ayons que l’industrie trouve la sagesse et la volonté de les éviter. L’industrie est la première à reconnaître qu’elle prend le chemin opposé, malgré Three Mile Island, malgré Tchernobyl (11). Ce qui ne signifie qu’une chose : ce pire que le sort, ou un dieu, lui a évité, elle ne le tient pas pour réel, simplement parce qu’il n’a pas eu lieu. C’est une faute gravissime.”
15 mars 2008 "Le Mal propre"
Dans son célèbre roman, L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera définit l'esthétique totalitaire comme "la négation absolue de la merde". Il compare le goulag à "une fosse où le kitsch totalitaire jette ses ordures". La métaphore postule un parallèle entre l'excrément et les victimes des procès truqués et des persécutions politiques.
Kundera pénètre au coeur du problème du totalitarisme, non pas grâce à un discours sociologique ou politique, mais de manière intuitive, à coup de métaphores et d'aphorismes. La victime est expulsée, refoulée, cachée. Nous avons honte d'en parler. Tout comme, à l'époque de mes grand-parents, on dissimulait encore le mot "merde" derrière des petits points ("m. . . . ."), tout comme, à l'époque actuelle, on interdit les présentateurs de prononcer des obscénités à la télévision ou à la radio, les régimes totalitaires font disparaître leurs victimes. Dans le premier cas, il s'agit d'une pratique anodine et si habituelle que nous ne nous en rendons même pas compte. Dans le deuxième cas il s'agit d'une régression vers des pratiques archaïques "cachées depuis la fondation du monde". Il ne faut pas mettre les deux phénomènes sur le même plan moral, bien entendu. Mais la comparaison que fait Kundera peut nous conduire à nous interroger sur le sens et l'intention de nos propres interdits. Pourquoi avons-nous honte de notre propre saleté? Pourquoi les obscénités sont-elles obscènes? Dans les sociétés dites "totalitaires", les traîtres sont effacés des photos et leurs noms disparaissent des archives. Leurs livres disparaissent des bibliothèques. Les ordures que nous jettons à la poubelle ou que nous envoyons Dieu sait où en tirant sur la chasse d'eau ne connaissent-elles pas un sort semblable?
Dans cette perspective, il n'est peut-être pas inutile de se rappeler qu'un des mots dans le Nouveau Testament qu'on traduit par "enfer" veut dire un endroit où l'on jettait des ordures: "Le mot gehenna est dérivé de l'expression hébraïque ge hinnom qui signifie la « vallée de Hinnom », une vallée située au sud de Jérusalem ... Anciennement, la vallée de Hinnom servait de décharge à ordures pour Jérusalem ; ces détritus étaient brûlés par des feux activés de soufre ou dévorés par les vers et les asticots. Il arrivait occasionnellement que le corps d'un criminel exécuté soit jeté dans le feu" ("Qu'est-ce que l'enfer"? Richard F. Ames http://www.mondedemain.org/articles.php?id=f006).
Ces quelques réflexions ont été suscitées par la parution d'un nouveau livre de Michel Serres, Le Mal propre (Le Pommier, 2008). Ce livre est provocateur, fascinant, et la thèse qu'il avance mérite qu'on en discute. Voilà, en guise de "bande annonce", un petit extrait du quatrième de couverture:
"Les tigres pissent pour délimiter leur niche. Ainsi font sangliers et chamois. Mimons-nous ces animaux ? Je le crains, je le vois, je le sens. Quiconque crache dans la soupe ou la salade s'en assure la propriété. Vous ne couchez pas dans des draps salis par un autre ; ils sont désormais à lui. Pour pouvoir recevoir ses clients, un hôtel, un restaurant, inversement, nettoient lit et serviettes. L'éthologie, science des conduites animales, comme les pratiques hospitalières – mais aussi l'histoire des religions, les techniques agricoles, même la sexologie… - montrent le rapport étrange et répulsif entre le sale et la propriété."
18 février 2008 "La Juste distance"
Pour ceux qui n’ont pas pu assister aux conférences de carême à Notre Dame ce dimanche, voici le lien qui permet de télécharger les interventions de Benoît Chantre et de Jean de Loisy :
www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/careme_catholique/
Les deux conférences portent sur Matthieu 16, 13-16 (« Et pour vous, qui suis-je ? ») et sur l’art. Les deux conférences sont remarquables mais celle de Chantre est particulièrement frappante. Elle développe, de façon magistrale, une métaphore de Pascal sur la peinture et la perspective pour en faire la clef d’une lecture explicitement mimétique du rapport entre Jésus et Pierre. Ce dernier reconnaît en Jésus le Messie mais, succombant à ce que Chantre appelle « l’enthousiasme », double trompeur de l’inspiration divine authentique, il le prend pour un roi conquérant à l’image de David. On peut imaginer que l’ambition brille dans ses yeux et que cette ambition menace de se transmettre (mimétiquement) à Jésus et ainsi de le détourner de sa mission. Jésus lui répond alors : « Passe derrière moi, Satan. Tu m’es un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes ».
Chantre souligne que Jésus ne demande pas d’être imité mais d’être suivi. Pour Chantre, « imitation » semble correspondre au « scandale », autrement dit à ce que Girard appelle la « médiation interne » ou le « désir métaphysique ». C’est un désir dangereux, contagieux, idolâtre, concurrentiel. A ce désir satanique, au sens quasi technique que Girard donne à la notion de Satan (étiquette qui désigne l’ensemble du processus mimétique), s’oppose celui de suivre Jésus en se tenant à la « juste distance ». Cette distinction permet à Chantre de définir la création artistique véritable comme l’effacement de soi, le refus d’imiter orgueilleusement le Christ comme le fait, par exemple, Kirillov, ce personnage dostoïevskien des Possédés. Pour ceux qui s’intéressent à l’avenir de l’art et aux problèmes de la création artistique, cette conférence fournit une façon saisissante de penser le rapport entre la religion et l’art à une époque où les artistes sont souvent en mal d’inspiration, sinon d’enthousiasme.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je ne peux que vous recommander de télécharger l'entretien que Jean-Michel Oughourlian a accordé au Nouvel Obs, encore disponible sur leur site web à l'adresse suivante: http://bibliobs.nouvelobs.com/jean-michel-oughourlian Il s'agit d'une présentation du dernier livre d'Oughourlian (Genèse du désir) ainsi que d'une exposition rapide de la théorie mimétique en général. Oughourlian explique pourquoi, pour lui, la manifestation clinique du désir mimétique, c'est la rivalité: le patient qui vient consulter n'étant jamais pleinement conscient de l'alterité qui le traverse, il ne peut pas -- et ne veut pas -- avouer la dimension mimétique de sa situation. En effet, au lieu de dire "Je suis en train d'imiter un
tel", nous explique Oughourlian, le patient dira toujours, "Un tel est un salaud parce qu'il essaie de me voler ma femme/me voler mon poste/me voler mes idées, etc." Dans l'univers de la médiation interne, le sujet est plus ou moins inconscient de la ressemblance entre lui est son modèle.
Cette ressemblance est pourtant réelle, et Oughourlian nous montre que les dernières techniques en neuroimagerie nous permettent de la vérifier. En montrant ce clip à des amis, j'ai constaté tout de suite que la partie qui porte sur les neurones miroirs est la plus convaincante pour quelqu'un qui n'est pas un lecteur de Girard. Les neurones miroirs suscitent beaucoup d'intérêt parmi les psychologues et je crois qu'un dialogue entre chercheurs en sciences cognitives et théoriciens du désir mimétique s'impose plus que jamais. Dans cette perspective, le colloque en octobre à l'hôpital américain a été un pas en avant important. Tel était aussi le principe derrière un colloque qui s'est tenu à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) il y a un mois maintenant, avec la participation de Robert Hamerton-Kelly, René Girard, Jean-Pierre Dupuy, Antonio Damasio, Marco Iacoboni et Scott Garrels. Etant maintenant en France, je n'ai pas pu assister à ce colloque, mais Scott Garrels m'en a dit des choses très positives. Girard et Hamerton-Kelly ont donné des conférences qui portaient sur la théorie mimétique en général, et ces conférences étaient suivies, le lendemain, d'une table ronde à laquelle tout le monde a participé.
Scott m'a dit que Marco Iacoboni, professeur à UCLA et grand spécialistes des neurones miroirs, n'était pas tout à fait convaincu par la théorie mimétique. Cela n'est peut-être pas très grave. En fait, c'est peut-être la preuve que, tout comme la théorie mimétique a besoin des scientifiques pour vérifier ses postulats, ls scientifiques ont besoin de la théorie mimétique pour comprendre pleinement l'imitation. Car si la méfiance envers l'hypothèse mimétique s'explique en partie par la réticence postmoderne vis-à-vis des théories "globales", c'est aussi la vision en fin de compte assez sombre de l'homme et de la nature humaine que nous propose Girard qui constitue une pierre d'achoppement pour le rousseau-isme universitaire. J'ai feuilleté l'autre jour un nouveau livre de Giacomo Rizzolati, intitulé tout simplement Les Neurones miroirs et qui vient de sortir chez Odile Jacob. Le livre est un peu trop technique pour moi, un littéraire, mais néanmoins très intéressant, surtout vers la fin où il est question de donner des définitions plus "philosophiques" et générales de l'imitation. Or le livre de Rizzolati propose une vision de l'imitation qui rentre dans le cadre de l'interprétation dominante. Celle-ci consiste à se concentrer sur l'empathie: les neurones miroirs nous permettraient de nous
identifier à l'autre et seraient donc source de sentiments "positifs", de liens entre les gens, etc. En tout cas, il n'est pas question de conflit ou de violence dans le livre de Rizzolati.
On m'affirme, cependant, que Rizzolati dit quelque part que les neurones miroirs peuvent s'avérer dangereux pour les singes... Le jour où les scientifiques développent et approfondissent cette intuition sera le jour où le vrai dialogue entre l'hypothèse mimétique et les sciences "dures" pourra commencer.
PS Je vous prie de m'excuser pour ma façon un peu sauvage de manier la langue française. J'ai l'habitude de me faire relire rapidement avant de mettre à jour ce blog mais cela prend trop de temps et exige surtout beaucoup trop d'indulgence de la part de mes amis francophones.


Review article published in Lingua Romana: A journal of French, Italian, and Romanian Culture (http://linguaromana.byu.edu/)
and reproduced here with the editor's permission:
In October 2007, the newly formed publishing house Carnets Nord released two books by key figures in the world of mimetic theory—Achever Clausewitz, by René Girard, and Genèse du désir by Jean-Michel Oughourlian. It might be said that both pose the same fundamental question, although Girard’s book deals primarily with events unfolding on the grand stage of history, and Oughourlian’s with more personal dramas: once war has been declared (between nations, ethnicities, religions, or even the members of a couple), is there any turning back? In Girard’s view, the modern departure of the gods exposes us to the perils of a perpetual and intensifying combat. “C’est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d’opprimer la vérité » reads the first line of the book’s epigraph, from Pascal’s Les Provinciales. In dialogue with his French publisher Benoît Chantre, and drawing on the most powerful passages of Carl von Clausewitz’s posthumous treatise On War, Girard explores modern history as an escalation to extremes, inscribing his own anthropological project in the wake of Hölderlin, Germaine de Stael, Baudelaire, and Péguy. Today, affirms Girard, the acceleration of history has attained apocalyptic proportions.
J'ai été frappé par plusieurs des interventions pendant le colloque sur la fin des guerres à Beaubourg le 25-26 novembre, à commencer par celle de Paul Dumouchel, qui tentait, si je l'ai bien compris, de montrer en quoi les attentats suicides pourraient être considérés comme à la fois des sacrifices venant purger des tensions à l'intérieur d'une communauté, et des actes guerriers visant à détruire une population extérieure, comme si la violence accumulée au sein du territoire palestinien, par exemple, était canalisée vers l'ennemi par le biais de l'attentat suicide. Ainsi deux fonctions qui sont, sous le régime sacrificiel traditionnel, nettement séparées dans l'espace et dans le temps--la fonction "sacrifice d'une victime" et la fonction "guerre menée à l'extérieur"--se retrouvent unifiées en un seul acte de terreur. En une seule figure violente, on retrouve la jubilation post-sacrificielle d'un coté (les bonbons distribués aux membres de la communauté réunie autour de la victime disparue), et la dévastation d'une violence meurtrière de l'autre (destruction d'un autobus, d'une boîte de nuit, d'un marché en plein air).
L'intervention de Michel Serres était également saisissante. Serres a commencé sa présentation en demandant à ses auditeurs de projeter sur l'écran de leur cinéma mental un petit film d'une bagarre entre marins dans un bar, film qu'il avait "tourné" à l'époque en tant que spectateur désintéressé. Sauf qu'il nous demandait de regarder ce film à l'envers, de la fin jusqu'au début. C'était, selon lui, la meilleure façon de saisir le mécanisme de la guerre d'autrefois, de la guerre juridique d'avant la Révolution française, cette guerre sacrée et en quelque sorte bien tempérée qui, au lieu de conduire à une montée inéluctable aux extrêmes, tendait à réduire à la fois le nombre de combatants et la quantité de violence. La guerre juridique, et avec elle la civilisation occidentale, aurait donc commencé avec l'affrontement entre les champions mythologiques, les trois Horaces et les trois Curiaces. Un peu comme Spassky et Fischer se disputant la guerre froide autour d'un échiquier, les trois Horaces de Tite-Live (dont la légende est reprise plus tard par Corneille) sont, pour Serres, des représentants de la populace, des victimes émissaires qui permettent de régler des conflits massifs avec des armes de destruction minimales.
Enfin, face à la violence apocalyptique entre les hommes, Serres nous a proposé de livrer ensemble une guerre contre le désastre écologique. Or, il y a quelques semaines, lors d'un colloque sur la violence et le désastre, Eric Gans de UCLA avait traité le réchauffement de la planète de "dernière des religions sacrificielles", en affirmant que la bataille écologique constituait justement une cause commune autour de laquelle toute la planète pourrait se réunir. Le coup imprévu de Serres était de revendiquer explicitement cette religion écologiste. Un peu plus tard, René Girard a remarqué qu'un des signes que l'Apocalypse a commencé, c'est qu'on a de plus en plus de mal à distinguer les effets de nos actions guerrières de ceux de nos actions de paix (l'industrie, la concurrence économique). C'est un exemple de plus de cette indifférenciation grandissante par laquelle notre époque se définit.
Après la conférence de René Girard, un des élèves de Richard Pin a posé deux très bonnes questions: 1) est-ce qu'on doit être chrétien pour comprendre à fond la théorie mimétique? et 2) est-ce que celui qui connaît la théorie mimétique est par là moins susceptible d'être violent? René Girard a répondu non aux deux questions--le fait de connaitre la théorie mimétique, a-t-il précisé, ne l'empêche pas de se mettre en colère contre ceux qui ne prennent pas au sérieux la théorie mimétique!
Girard a dit que l'Apocalypse, c'est l'impuissance d'un nouveau départ, l'impossibilité de fonder quoi que ce soit par la violence. De ce point de vue, l'intervention de Frédéric Gros au début du colloque a été particulièrement saisissante. Frédéric Gros a souligné l'émergence d'une nouvelle catégorie, caractéristique de l'ère nouvelle dans laquelle nous sommes entrés : l'ennemi comme quantité connue, comme différence visible venant de l'extérieur (couleur de peau différente, uniforme différent, etc.) cède la place au "suspect" dont rien de nous permet de le distinguer de nos semblables, car il est--ou pourrait être--notre voisin de palier. Le suspect c'est l'ennemi transformé en frère, la menace extérieure transformée en violence éclatant de manière imprévisible à l'intérieur de la communauté. Sans pouvoir expulser l'ennemi, sans pouvoir le réléguer à un espace autre qui se retrouve par delà nos frontières, nous sommes incapable de créer un espace culturel à l'abri de la violence, une zone non contaminée. Le suspect, c'est une grande figure de l'Apocalypse, un symbole de la violence endémique sans remède sacrificiel possible.
20 décembre 2007 « Colère et temps, notes de lecture »
Mais selon Sloterdijk, la prééminence de la colère (on a parfois du mal à savoir s’il en fait l’éloge ou la critique) a été également méconnue par la pensée d’inspiration freudienne qui met en avant la dimension érotique et laisse ainsi dans les ombres la fierté, l’ambition, la colère etc., en bref, toute une constellation d’affects qui forment ensemble ce que Sloterdijk appelle les « energies thymothiques », du mot grec « thymós ». Sloterdijk essaie donc de susciter en nous « le soupçon que la psychanalyse – laquelle a largement servi, au XXe siècle, de discipline pilote dans le domaine de la psychologie – a certainement méconnu, sur un point essentiel, la nature de son objet » (p. 25).
Colère et temps est aussi une révision de la pensée Nietzschéenne, dans la mesure où Sloterdijk refocalise l’analyse du ressentiment afin d’aborder les divers mouvements révolutionnaires des dix-neuvième et vingtième siècles. En parlant de Nietzsche, il écrit : « Si la répression refoulement du ressentiment constituait réellement la priorité absolue, alors le « règlement de compte » avec le christianisme devait passer au deuxième plan, derrière la lutte contre le « Muckertum »--ce revanchisme philistin des révolutionnaires nationaux et internationnaux » (p. 44). Ainsi Sloterdijk consacre le chapitre le plus long de son livre à l’étude de « la banque mondiale communiste de la colère ».
Sloterdijk ne fait pas référence à René Girard dans son texte, du moins pas explicitement. Cependant, dans la troisième partie de son livre, qui porte sur l’époque contemporaine, on trouve le passage suivant, avec une note de bas de page renvoyant le lecteur à la postface qu’il a composée pour Je vois Satan tomber comme l’éclair : « Ce sont désormais bien sûr les prescriptions d’abstinence et les interdictions anti-mimétiques de la jalousie formulées par le Décalogue qu’il faut, pour être moderne, mettre entre parenthèses et remplacer par leur contraire. Si le dixième commandement affirmait : « Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son esclave mâle ou femelle… ! » (Exode, 20, 17), le premier commandement du nouveau système moral en vigueur formule pour sa part : Tu dois désirer tout et jouir de tout ce que les autres jouissants te présentent comme un bien désirable ! De là découle immédiatement le deuxième commandement, censé renforcer les effets du premier. C’est un commandement d’exhibition qui, diamétralement opposé aux préceptes de discrétion traditionnels, élève l’exposition ouverte et place l’imitation de la jouissance personnelle au rang de norme » (p. 280-281).
Ainsi la société de consommation moderne se définit par une exaspération croissante du mimétisme, par l’affichage ouvert de ce qu’il fallait cacher autrefois. La visibilité est tout, « image is everything, » comme l’a affirmé il y a quelques années une publicité pour les appareils photos Canon.
L’analyse de Sloterdijk me parait ici exacte, à ceci près qu’elle néglige un peu la contradiction interne nécessaire entre un mouvement de désir visant les biens ou l’être de l’autre, et un projet d’autopublicité qui cherche à rendre l’individu plus visible et donc plus désirable. Le premier mouvement est centrifuge ; le deuxième, centripète. Il faut donc supprimer l’élan centrifuge afin d’assurer l’accomplissement du projet d’autopublicité. On ne peut désirer ce que l’autre possède (ou ce qu’il est) qu’en tentant d’inscrire ce désir dans le projet de proclamation de sa propre autosuffisance. De cette contradiction interne est né le ressentiment, généré de manière inévitable par le va-et-vient d’un désir d’autant plus aiguisé qu’il ne peut pas se manifester en tant que désir et doit donc épouser des formes détournées, qui va de la dérision et le sarcasme jusqu`à la colère et la haine. C’est peut-être à cet autoempoisonnement que Sloterdijk fait référence quand il écrit que, « pour compenser les effets dangereux des deux commandements, » il en faut un troisième : « Tu ne dois attribuer à nul autre qu`à toi-même d’éventuels insuccès dans la compétition pour l’accès aux objets de la convoitise et aux privilèges de la jouissance » (p. 281).
Ainsi le livre de Sloterdijk semble parfois ignorer le lien fort entre la convoitise (qu’il est obligé de désaccentuer pour faire ressortir l’importance de la colère) et la genèse de toute la gamme de sentiments thymotiques. Tout comme Nietzsche, Sloterdijk essaie de distinguer entre deux types de mouvements psychologiques fondamentaux, sans reconnaître que la fierté thymotique, portée à son aboutissement logique, débouche finalement sur le ressentiment, au moins lorsqu’elle finit par trouver ce qu’elle a cherché, c’est-à-dire un rival capable de la battre. De cette manière, l’autoaffirmation se retrouve finalement prise dans une structure de rivalité qui ressemble fort à ce que Girard appellerait le skandalon, rivée à un modèle admiré et détesté. La distinction que fait Sloterdijk entre la colère et la convoitise mimétique me semble donc, au fond, trop abstraite, même si elle tient encore à un niveau assez superficiel.
Je donnerai comme exemple du lien étroit entre la convoitise mimétique et la colère le cas d’Achille, que Sloterdijk cite au tout début de son ouvrage pour marquer l’importance capitale de la colère pour l’imaginaire occidental. Or d’où vient la colère d’Achille ? Du fait qu’Agamemnon veut lui enlever Briséis, la jeune troyenne dont Achille avait tué les frères et l’époux… Sloterdijk n’en parle pas, et il peut à bon droit ne pas le faire ; peut-être omet-il ce détail par souci de contrer l’interprétation selon lui dominante de l’érotisation de l’être humain. Mais dès qu’on incorpore ce fait dans la trame du récit, on retrouve la continuité réelle des interactions humaines. Autrement dit : en partant de la seule perspective de Sloterdijk, on serait incapable de tourner un film sur la colère d’Achille. Ainsi la perspective « thymotique » me parait en fin de compte telle une surcompensation qui s’efforce de gommer une partie cruciale des interactions « cinématographiques » afin de soutenir les thèses Nietzschéennes.
On se souviendra de l’article paru dans Le Monde du 22 novembre, où Sloterdijk critique Girard dans des termes à peu près semblables à ceux dont il se sert pour critiquer la psychanalyse dans le présent livre. On y voit une tentative, me semble-t-il, pour refouler l’identité fondamentale entre la dynamique thymotique et le désir mimétique. Sloterdijk veut dissocier les deux, mais derrière son discours on voit resurgir leur ressemblance : « Girard est un grand naturaliste de la fierté, mais il s'est laissé prendre par l'érotisme de la psychanalyse. Pour lui, la rivalité mimétique est un érotisme dégénéré, une expression du vouloir avoir, bref du péché originel. Dans sa conception de la psyché humaine, il n'y a pas de place pour la dynamique de la colère, du "thymos" grec, qu'il ne faut pas confondre avec le désir érotique. Il ne prend pas en compte cette bipolarité platonicienne entre érotisme et thymothisme. (P. Sloterdijk, Le Monde 22.11.07) »
Je dirais, pour ma part, que Sloterdijk est un grand naturaliste du mimétisme réciproque, dont il donne, du reste, des descriptions saisissantes, comme celle-ci, à la page 36, qui vaut aussi bien pour les individus que pour les collectifs : « Dès que l’on a franchi le palier de l’ignorance mutuelle initiale entre plusieurs collectifs métaboliques, c’est-à-dire lorsque la non-perception réciproque a cédé du terrain, ils sont inévitablement soumis à la pression de la comparaison et à la contrainte de gérer leurs relations aux autres. On entre ainsi dans une dimension que l’on peut désigner comme celle de la politique extérieure, au sens large. Lorsqu’ils deviennent réels les uns pour les autres, les collectifs commencent à se concevoir mutuellement comme des entités coexistantes. La conscience de la coexistence permet de percevoir les étrangers comme des stresseurs chroniques, et il faut transformer en institutions les relations que l’on a avec eux – en règle générale sous la forme de préparatifs de conflits ou d’efforts diplomatiques pour s’assurer la bienveillance de l’autre partie […] Les poisons du voisinage s’infiltrent dans les ensembles qui se réfèrent les uns aux autres ».
Le marivaudage postmoderne selon Frédéric Beigbeder :
« Pour que les gens tombent amoureux de vous, il n’y a pas trente-six méthodes: il faut faire semblant de s’en foutre complètement. Stratagème infaillible. Les hommes et les femmes sont pareils : ils deviennent fous de ceux qui s’en foutent. J’aime Claire parce qu’elle ne fait même pas semblant : elle se fiche vraiment de moi. Ou plutôt devrais-je dire : elle s’en fout éperdument. L’amour c’est cela : faire croire à la personne qu’on désire le plus au monde qu’elle nous laisse de marbre. L’amour consiste à jouer la comédie de l’indifférence, à cacher ses battements du cœur, à dire l’inverse de ce qu’on ressent. Fondamentalement, l’amour est une escroquerie » (Frédéric Beigbeder, L’égoïste romantique, p. 88).
« Croisé Claire : grosse déconvenue. Dans mon souvenir, elle était plus belle et je l’aimais bien davantage ; je savourais chaque seconde. (Avec elle, les secondes duraient plus que des secondes. Chaque seconde était une première.) Et là, pfuitt, la magie s’était évaporée, le charme n’agissait plus. Par paresse, orgueil, crainte de souffrir, nous nous étions éloignés l’un de l’autre et nos sentiments se retrouvaient obsolètes, impossibles à ranimer. Je ne voyais plus qu’une rouquine hystérique aux seins flasques, aux vêtements vulgaires, au maquillage outrancier. Seul le papillon tatoué sur sa jambe me rappelait que c’était bien celle dont j’étais encore fou de désir il y a quelques semaines » (L’égoïste romantique, p. 110).
11 décembre 2007 « Un fait
divers »
Un article du New York Times (« Helicopter Parenting Turns Deadly », Judith Warner) paru il y a quelques jours raconte la mort, aux Etats-Unis, d'une fille de 13 ans, Megan Meier, qui s'est suicidée après qu'un ami l'a injuriée sur Internet. Megan n'avait jamais rencontré Josh, qui s'avère être, en réalité, une femme de 47 ans et non un beau garçon de 16 ans. Elle se trouve être la mère d'une ancienne copine que Megan avait brusquement laissé tomber. Cette mère de famille a créé une fausse identité sur Internet afin de se venger du sale coup que Megan avait fait subir à sa fille. Après une période de flirt, la mère a commencé le harcèlement : « Je n'aime pas ta façon de te comporter avec tes amies » ; « le monde serait meilleur si tu n'existais pas ». Quelques minutes après avoir lu ce dernier message, Megan s'est pendue dans le placard de sa chambre.
Ce fait divers lugubre a nourri pendant quelques jours les médias américains. Il a aussi soulevé des questions difficiles à propos de la façon dont les parents devraient se comporter avec leurs enfants. Depuis les années soixante, on peut constater une transformation dans le rapport parent-enfant, une perte de différenciation dans les rôles. « À l'époque, dit la psychologue Madeline Levine, on s'attendait à ce que les parents fonctionnent à un autre niveau que les enfants. » (ma traduction) « Maintenant, dit-elle, toute cette notion selon laquelle les parents occupent une autre sphère que celle de leurs enfants est en train de disparaitre ». Autrement dit, on est entré pleinement dans la sphère de la médiation interne, celle d'un jeunisme généralisé qui, pour des raisons diverses, idéalise les enfants et les érige en idoles, tout en les privant très tôt de leur innocence.
A-t-on atteint de tels extrêmes en France ? J'ai tendance à croire que les Etats-Unis sont Dostoeivskiens et apocalyptiques, que la société américaine est complètement atomisée, désagrégée et désaxée, et que la France, en revanche, encore un peu plus « Proustien », pour ainsi dire, tient toujours à certaines vieilles traditions, aux dîners en famille, par exemple, ou à une certaine modestie vestimentaire et sexuelle qui n'a rien de Puritain et qui protège la sexualité des déboires d'une toute-permissivité sans limites. Mais cela pourrait être une erreur de perspective de ma part...
15 novembre 2007 "Road Rage"
On connaît le lieu commun selon lequel la voiture représente la liberté individuelle aux Etats-Unis. Or, à Los Angeles, ce lieu commun désigne une réalité concrète. Los Angeles est une ville "rhizome" avec des centres commerciaux et des petits quartiers piétons mis en réseau par des autoroutes à cinq voies. Le système de transport en commun ne dessert pas toute la ville : il n’y a pas de station de métro à Westwood (la partie de LA où se trouve le campus de UCLA) ou à Santa Monica. Tout le monde se déplace donc en voiture.
Dès le matin, chaque conducteur démarre sa voiture pour aller au bureau. Il quitte son quartier et se dirige vers l’autoroute 405. Cet immense ruban d’asphalte est plein de voitures qui roulent lentement vers la ville. Il n’y a pas beaucoup d’embouteillages car à LA l’embouteillage est quasiment permanent. Les conducteurs parlent au téléphone tout en se regardant. Leurs efforts pour gagner un peu de temps aboutissent à un résultat paradoxal : lorsqu’une voiture change de voie, les autres conducteurs doivent freiner. Les conducteurs pressés ressentent de la frustration et essayent de changer de voie. Cela ralentit encore plus la circulation.
En général, les conducteurs à Los Angeles roulent tranquillement. Mais parfois un incident insignifiant peut mener à une explosion de colère. C’est ce qu’on appelle « road rage ». Le phénomène est bien connu et appartient à l’univers de la médiation interne. Un conducteur un peu paranoïaque regarde les autres voitures. Il a l’impression que la voiture rouge à sa droite est en train de lui barrer la route. Comme Œdipe devant son père sur la route de Thèbes, il réagit mal. Il imite l’autre conducteur et essaie de se venger en le doublant. Puis il s’arrête soudainement. La voiture derrière doit s’arrêter aussi. C’est une manœuvre dangereuse. Les conducteurs échangent des gestes éloquents et se regardent, furieux. Parfois ce genre d’altercation tourne mal. Les conducteurs sortent de leurs voitures et se battent dans la rue. Ou bien, un des conducteurs suit l’autre pendant des kilomètres. Quand sa proie s’arrête, il sort de sa voiture et essaie de le frapper, voire de le tuer.
Parfois les duellistes contribuent au ralentissement de la circulation. Un conducteur regarde dans le rétroviseur et constate qu’une voiture veut le doubler. Indigné, il fait exprès de conduire plus lentement afin de frustrer le conducteur inconnu. Mais il ne va pas jusqu’à conduire très lentement. Il roule assez lentement pour ennuyer l’autre conducteur mais assez rapidement pour que celui-ci ne puisse pas le doubler ! Les conducteurs restent anonymes les uns pour les autres et ils peuvent donc se permettre ce genre de conduite antisociale. À Los Angeles, on voit très peu de policiers sur l’autoroute 405 (peut être a-t-on plus besoin d'eux dans les quartiers sensibles de l’est de la ville...). La route est donc un lieu un peu sauvage, en dehors de la loi. On peut y décharger la colère accumulée pendant une longue journée de travail et de stress. On hurle de rage et esquisse des gestes obscènes. Les hommes y sont transformés en bêtes, emprisonnés dans leurs cages d’acier, de verre, et de caoutchouc.
7 Novembre 2007 "Sortir le marketing de sa crise actuelle"
D’où vient l’authentique différence ? C’est la question que je me suis posée en relisant Les ressorts cachés du désir : trois issues à la crises des marques par Marie-Claude Sicard. Dans un style vif et élégant, Sicard montre que la démocratisation des produits de luxe menace les marques d’une grave crise. Les marques de grande consommation imitent les marques de luxe et vice versa. Par conséquent, les produits ne servent quasiment plus aux consommateurs comme support de leur différenciation. Sicard considère que le marketing partage la responsabilité de cette crise. « Le marketing devrait être l’instance régulatrice qui oppose à l’indifférenciation grandissante des marques et des produits une authentique défense et illustration de la différence », écrit Sicard. « Mais la mission est peut-être au-dessus de ses forces, ou bien elle a été oubliée quelque part en chemin » (p. 220). Et elle ajoute plus loin, « La promptitude avec laquelle les consommateurs repèrent aujourd’hui les moindres manœuvres du marketing est le signe de cet échec » (p. 269).
Que peut-on faire ? Pour les consommateurs, il s’agirait de prendre conscience de leur servitude volontaire. Mais s’il se lit très facilement, ce livre s’adresse finalement aux professionnels du métier. « Sortir le marketing de sa crise actuelle », écrit Sicard. Pour ce faire, il faut s’interroger sur l’ambition du marketing, sur son vouloir être. « Ce qu’il voudrait être ? Une science. Mais pas n’importe quelle science. Une vraie science, c’est-à-dire une science dure, une science exacte, devant laquelle tout le monde s’incline sans discuter. Comme la physique, ou la biologie » (p. 280). Le marketing se prend pour une science, mais il se trompe. Il lui faut donc changer de modèle. Au lieu de se servir des outils de la science dure de l’industrialisation du siècle dernier (« quantification, rationalité logico-mathématique, prééminence du modèle mécaniste » p. 281), il devrait imiter d’autres disciplines : « Les théories du chaos, la théorie mathématique des catastrophes … l’étude des systèmes dynamiques « non linéaires » ou « loin de l’équilibre » (p. 289). Et Sicard de conclure : « On pourrait suggérer au marketing, s’il veut se tirer du pétrin où il est fourré en ce moment – et s’il veut toujours choisir la science pour modèle –, de choisir la science d’aujourd’hui, et non pas celle d’avant-hier » (p. 290).
J’apprécie beaucoup ce livre, qui porte sur un sujet spécifique est essaie de l’éclairer à la lumière de la théorie mimétique. Sicard n’ôte pas au marketing son modèle mimétique mais lui suggère tout simplement de substituer un nouveau modèle à celui, caduque et inadapté à l’époque actuelle, de la production industrielle du début du vingtième siècle. C’est peut-être ainsi qu’on peut sortir du mauvais mimétisme, non pas en essayant de s’y soustraire entièrement mais au contraire en revendiquant une imitation plus saine et en fin de compte plus attractive.
19 Octobre 2007 "Achever Clausewitz"
La façon dont René Girard tente d’y parvenir mérite d’être soulignée. Dans Des Choses cachées, Girard affirmait la différence irréductible entre la perspective sacrificielle et le judéo-chrétien mais refusait le « sacrifice de soi » comme alternative au « sacrifice de l’autre » de la religion archaïque. Le judéo-chrétien lui apparaissait alors comme d’un autre ordre et comme un au-delà du mimétisme. Aujourd’hui, sa vision des choses a changé. « J’ai longtemps essayé de penser le christianisme comme une position de surplomb, et j’ai dû y renoncer. J’ai maintenant la conviction que c’est de l’intérieur du mimétisme qu’il faut penser », écrit Girard.
Cette façon de « penser le mimétisme de l’intérieur » donne des résultats saisissants, un refus de réconciliations « sirupeuses » et de solutions faciles. Ainsi, Girard défend la théorie de la « montée aux extrêmes » de Clausewitz contre la dialectique de Hegel. Ce dernier semble penser la crise comme une étape obligatoire sur la route de la réconciliation. Aujourd’hui, il est encore tentant de vouloir d’abord passer par la violence pour déboucher ensuite sur un avenir plus paisible. C’est en quelque sorte la catharsis des grecs appliquée sur le plan historique. Par opposition à Hegel, Clausewitz ne se fait pas d’illusions sur la possibilité d’une telle réconciliation immanente au mécanisme de la violence. De même, René Girard ne cherche pas à rassurer ses lecteurs avec des pronostics optimistes. C’est peut-être pour cela que, de toutes ses apologies du christianisme, Achever Clausewitz est celle qui convainc le plus.
12 Octobre 2007 « Genèse du désir »
La prémisse sous-jacente du livre est simple : ceux qui sont enfermés dans des rivalités stériles peuvent s’en détacher progressivement s’ils consentent à voir l’altérité de leur propre désir. Dans un monde sans barrières sacrées pour canaliser le désir, toute relation s’expose, plus que jamais, aux menaces d’un mimétisme négatif. De l’état édénique qui est celui du début d’une relation, tout couple risque de passer plus ou moins rapidement à la chute et à l’expulsion du paradis, dès lors que la jalousie s’insinue au coeur de leur ménage. Selon Oughourlian, le meilleur remède dont nous disposions pour contrer ce phénomène est une compréhension plus claire et plus juste de nous-mêmes et de notre désir, afin de cultiver l’amour et l’entendement mutuel.
Au début du livre, l’auteur nous présente quelques études de cas. Ce sont des couples perdus dans un labyrinthe de jalousie, d’angoisse, ou d’incompréhension. Au lieu de nous raconter la fin de ces histoires, l’auteur passe sur-le-champ à des discussions plus théoriques. Il cherche à nous convaincre que le désir est mimétique et il développe la « psychologie interdividuelle » ébauchée déjà, avec René Girard et Guy Lefort, dans Des Choses cachées depuis la fondation du monde. Dans une deuxième partie, il se lance dans une exégèse remarquable de l’histoire d’Adam et Ève. C’est une lecture fascinante et audacieuse du récit de la chute. Le triangle formé par Adam, Ève, et le serpent est en quelque sorte archétypale, nous dit Oughourlian. Ce chapitre me remplit d’enthousiasme par sa façon de mélanger interprétation, saynètes fictives, et théorie.
La troisième partie raconte la découverte des neurones miroirs par des chercheurs italiens dans les années 1990. « Les neurones miroirs donnent enfin une démonstration expérimentale de la place centrale de la mimésis au coeur de la psychologie et prouvent que le désir est mimétique, ainsi que René Girard l’avait postulé dès 1961 », écrit Oughourlian. Ce sont des neurones qui « s’activent quand on réalise une action et quand on observe quelqu’un d’autre la réaliser ». Dans la quatrième et dernière partie du livre, Oughourlian revient vers les études de cas présentés dans son introduction pour nous donner enfin la suite de ces narrations, qui permet de vérifier la théorie mimétique dans le domaine de la psychothérapie. C’est la partie du livre qui m’a a priori le plus intéressé, car « c’est par le fruit que l’on connaît l’arbre ». Certains de ces couples arrivent à suivre le fil d’Ariane que leur propose Oughourlian et leur situation s’améliore. D’autres ont plus de mal à se laisser guider par ce fil. Mais pour les uns et les autres la psychothérapie mimétique, précisément parce qu’elle n’est pas une panacée mais une manière d’assumer sa propre liberté, représente une voie possible de guérison. On ferme ce livre avec l’impression d’avoir acquis un peu de la lucidité de son auteur, et ce n’est pas peu dire.
7 Octobre 2007 « Jenufa »
Jenufa raconte l’histoire d’une jeune femme qui a accouché d’un enfant illégitime. Sans père, l’enfant doit être caché avec sa mère pendant plusieurs mois, pour que les habitants du petit village ne découvrent pas la vérité. La belle-mère de Jenufa, Kostelnička, prend l’enfant et le tue en secret afin d’assurer le mariage de sa belle-fille. Dans le troisième acte, au moment où la cérémonie matrimoniale est censée avoir lieu, quelqu’un découvre le corps du petit.
C’est alors que se manifeste la signification chrétienne de Jenufa. Les habitants du village prennent des pierres pour lapider Jenufa, croyant à sa culpabilité. Kostelnička intervient au dernier moment et avoue son crime. Maintenant c’est elle qui s’expose à la violence collective du village. Dans la mise en scène de l’opéra de Los Angeles, Kostelnička est seule au centre d’un cercle de villageois qui la menacent les bras levés et avec des pierres à la main. Jenufa leur demande alors de donner à sa belle-mère le temps de se repentir. Grâce à ce geste de clémence, Kostelnička échappe aussi à la mort.
Jenufa porte le titre de l’héroïne mais c’est le voyage spirituel de Kostelnička qui confère à l’opéra son caractère dramatique. Sa chute ressemble à celle de Raskolnikov, qui avoue son crime à la fin de Crime et châtiment. Mais la présence de la foule rappelle également l’histoire biblique de la femme adultère que Jésus sauve de la lapidation. Cette présence ajoute une dimension collective et « folklorique » au dévoilement de la vérité. En effet, c’est le village entier qui se trouve impliqué dans le crime de la belle-mère, car cette dernière occupe une position importante dans la hiérarchie ecclésiastique locale ; sa décision de tuer l’enfant reflète l’atmosphère de désordre social et moral qui règne parmi les villageois dès le début de l’action. À la fin du drame, le sacrifice de soi de Kostelnička renverse la mauvaise réciprocité et rend possible la réconciliation finale. Ces derniers moments de l’opéra sont d’une grande efficacité. On ressent avec l’héroïne toute la joie de voir percer l’aube de sa nouvelle vie avec Laca, son promis.
28 Septembre 2007 « Les lunettes de soleil et la médiation interne »
Andrew Meltzoff de l’Université de Washington a fait des expériences qui montrent que l’être humain est programmé à suivre les regards des autres (http://www.mimetictheory.org/bios/meltzoff.html). Si je regarde dans le ciel, les autres vont faire de même. Or le regard porte souvent sur l’objet de désir. Voir les yeux des autres, suivre leur regard, est une façon de déterminer ce qu’ils désirent. En cachant les yeux du porteur, les lunettes de soleil masquent la direction du regard et donc le désir de la personne. En même temps, elles permettent à cette personne d’appréhender les désirs des personnes qui l’entourent, et, en distinguant celui qui les porte, elles attirent les regards de ces autres.
Être « cool » équivaut, dans ce cas au moins, à cacher son désir et à forcer l’autre à dévoiler le sien. Ses yeux étant cachés, celui qui porte des lunettes de soleil a forcément l’air de désirer moins intensément que les autres. La personne « cool » appartient donc à l’époque de ce que Girard appelle la « médiation interne ». Dans l’univers de la médiation interne, les modèles de notre désir (ceux qu’on regarde) sont également des rivaux (on s’en méfie). Les gens se méfient les uns des autres tout on s’épiant réciproquement. Ils deviennent plus paranoïaques, plus passifs, mais aussi plus sujets à des revirements soudains et violents. Plus l’approche du médiateur nécessite des stratégies nouvelles pour maintenir l’illusion d’indépendance, plus le désir doit se cacher derrière une ascèse parodique. D’où la popularité du mot « cool » pour désigner l’aura de puissance et d’autonomie qui va de pair avec la répression de tout désir « chaleureux » et humain.
21 Septembre 2007 "Le marivaudage postmoderne"
Le combiné dans les mains j'hésite et je raccroche
Pas pressé d' passer pour celui qui s'accroche
Fébrile et collant ça donne pas vraiment envie
Lointain et distant, j' sais pas pourquoi mais c'est sexy
Même si je ne pense qu'à elle, si je rêve de la revoir
Vade retro téléphone, elle ne doit pas le savoir
Tout le monde ou presque connaît aussi la "règle des trois jours," respectée come une règle sacrosainte :
Nos meilleurs techniciens se sont penchés sur la formule
C'est trois jours au moins le résultat de leurs calculs
Si le jeune homme ne dissimule pas son désir pour la fille, le narcissisme de cette dernière grandira et son intérêt pour lui sera proportionnellement diminué. Car, comme l'a dit Stendhal, il ne faut pas dire à une femme vaniteuse qu'on la trouve jolie. Il semble que désormais toutes les femmes soient susceptibles de repousser les hommes trop épris, tandis que les hommes ont également tendance à repousser les filles gentilles et disponibles. Tout le monde cherche l'objet de fuite, tout le monde fuit le sujet de poursuite. Pour certains, ce genre de jeu et divertissant, ou au moins tolérable. Mais pour d'autres il devient un véritable enfer. Que doit-on faire si l'on trouve répétitif et absurde de courir toujours après celui qui est « lointain et distant » ?
La seule façon de sortir du cercle vicieux est d'imiter un modèle qui ne risque pas de devenir un obstacle, quelqu'un de bienveillant et de compréhensif, un mentor qui peut nous montrer le bon chemin. Jésus en est le meilleur exemple. Son désir s'oriente toujours vers le haut, vers son Père, tel un acteur qui s'efforce d'incarner l'être de son personnage. Si nous l'imitons, notre désir ne butera contre aucun obstacle. À la différence de la situation décrite dans la chanson, l'imitatio Christi ne devrait pas susciter la méfiance, car Jésus ne cherche pas dans les regards qui sont tournés vers lui la preuve de son pouvoir de séduction. Il ne trouve pas méprisable qu'on veuille toucher ses habits. Tels certains athlètes qui signent humblement des centaines d'autographes pour leurs jeunes admirateurs, il assume pleinement son rôle de modèle. Le jour où ils se mettent à imiter un tel modèle au lieu de se livrer à des jeux de l'amour et du hasard, les gens s'appelleront sans avoir peur de "passer pour celui qui s'accroche". En attendant, nos amoureux peuvent chanter ensemble le refrain de "Vade retro téléphone":
Faut pas qu' j'l'appelle, pas qu' j'l'appelle
Attendre encore quelques jours
Faut pas qu' j'l'appelle, pas qu' j'l'appelle
Pas encore c'est trop court
16 septembre 2007 « La Conversion créatrice
selon Kundera et Girard »
« Si j'imagine la genèse d'un romancier en forme de récit exemplaire, de « mythe », cette genèse m'apparaît comme l'histoire d'une conversion ; Saül devient Paul ; le romancier naît sur les ruines de son monde lyrique ». Dans cette citation de son dernier livre, Le rideau (Gallimard, 2005), Milan Kundera fait discrètement allusion à sa propre expérience « romanesque ». Poète communiste engagé dans sa jeunesse, il se met à écrire des nouvelles comiques et ironiques vers l'âge de 30 ans. « La conversion anti-lyrique est une expérience fondamentale dans le curriculum vitae du romancier »,écrit Kundera. « Eloigné de lui-même, il se voit soudain à distance, étonné de ne pas être celui pour qui il se prenait. »
Comparons ce passage à ce que dit René Girard a ce sujet, dans un entretien avec Jean-Claude Guillebaud (Le Nouvel Observateur, 01.07.2004) : « Je définis donc comme «conversion» le pouvoir de se détacher suffisamment de soi pour dévoiler ce qu'il y a de plus secrètement public en chacun de nous, le modèle, collectif ou individuel, qui domine notre désir. Il faut renoncer à s'agripper (consciemment ou inconsciemment) à autrui comme à un moi plus moi que moi-même, celui que je rêve d'absorber. »
On remarque tout de suite les parallèles, l'accent mis sur le détachement de soi, le dévoilement d'un malentendu. La conversion permet à l'auteur de prendre conscience de son propre mimétisme. Il a tendance à se prendre pour un héros victorieux alors qu'en réalité il est avant tout l'imitateur de ce héros. C'est cette vérité que Kundera a dû découvrir avant d'écrire un de ses premiers textes « anti-lyriques », « Docteur Havel Vingt Ans Après » (du recueil Risibles amours), dans lequel un jeune journaliste repousse sa jolie copine et, de manière assez quichottesque, part à la conquête d'une femme vieillissante, pour la seule raison que cela lui a été recommandée par son modèle.
12 septembre 2007 "The Self-Referential Hypothesis in Finance"
"L'exubérance irrationnelle"… L’expression tant citée de Greenspan est rassurante ; elle suppose l'existence d'une rationalité bien tempérée qui permettrait d'éviter les bulles.
Mais l'idée d’une opposition nette entre le cow-boy irrationnel et l'investisseur prudent n'est pas valable car leur comportement à tous les deux est avant tout imitatif. Afin d’illustrer ce propos, envisageons un scénario mettant en scène un courtier travaillant sur le marché des changes. Il croit que l'euro est sous-évalué, pourtant il regarde son écran d'ordinateur et constate (ou croit constater) que les autres courtiers sont prêts à vendre. Sa propre opinion ne s'accorde pas avec la majorité. Il a donc deux possibilités: il peut garder ses euros et perdre de l’argent ou les vendre, comme tous les autres, pour en gagner plus tard lorsque le prix aura baissé. Il fait le choix rationnel, celui dicté par un intérêt personnel éclairé: il suit ce qu'il croit être l'opinion majoritaire et vend ses euros.
Avant de prendre sa décision, ce courtier a dû anticiper l'opinion de ses homologues. D'après lui, les autres courtiers ont fondamentalement tort et la réalité économique est de son côté; le cours de l'euro devrait donc monter. Eux ne font que suivre une tendance irraisonnée. Cependant, il doit se soumettre à leur croyance, aussi irrationnelle soit-elle. Il se voit comme un îlot de rationalité perdu dans une mer de "morosité irrationnelle", seul contre tous.
Il n'est probablement pas le seul à se sentir isolé. L'exemple précédent est tiré de "The Self-referential hypothesis in finance," un article écrit par l'économiste André Orléan et disponible sur sa page personnelle (www.pse.ens.fr/orlean). Orléan nous explique que le courtier qui va à l'encontre de sa croyance personnelle afin de suivre "la croyance du marché" est sans doute loin d'être exceptionnel. Il est bien possible que, tout comme lui, chacun de ses homologues estime que le cours de l'euro devrait monter mais que la tendance générale est à la baisse. Chacun décide à contrecoeur de vendre ses euros afin de les racheter plus tard, sachant malgré ses doutes intérieurs que cette démarche est la plus rationnelle. Et chacun de voir ses prévisions se confirmer lorsque le cours de l'euro baisse en conséquence de cette puissante vague de mimétisme collectif. De ce point de vue, les tendances du marché ne relèvent pas de l'irrationalité pure mais plutôt d'un mélange subtil d'intérêt personnel éclairé et d'aveugle servitude volontaire.
30 août 2007 "La bouc émissarisation dans la crise hypothécaire"
"Comme dans toute crise il faut trouver des boucs émissaires. Les agences ont leur part de responsabilité mais ne sont pas plus coupables que les banques qui ont prêté n'importe quoi à n'importe qui" (Benoît Hubaud, directeur de la recherche à la Société générale)
Cité dans un article du Monde du 17 août sur la crise hypothécaire, Benoît Hubaud, directeur de la recherche à la Société générale, utilise le terme de bouc émissaire pour parler des agences de notations accusées d'avoir provoqué cette crise. Au sens propre du terme, "bouc émissaire" fait référence à un rite ancien des Hébreux dans lequel un bouc, chargé des forfaits de la communauté, était envoyé dans le désert. Le sens figuré de ce terme est apparu dans la langue française au XVIIIème et XIXème siècles. Il définissait alors "l'homme sur lequel on fait retomber les torts des autres". Le travail de René Girard a renouvelé notre compréhension de cette expression. Ses livres montrent que l'utilisation courante du terme "bouc émissaire" reflète le souci moderne des victimes, d'inspiration judéo-chrétienne. En effet, les textes bibliques dénoncent les persécutions et les religions païennes qui ritualisent la mise à mort des victimes. À notre époque, l'influence de ces textes se fait sentir même parmi ceux qui livrent une opposition acharnée au christianisme. S'appuyant inconsciemment sur l'éthique biblique, les sociétés séculaires de l'occident considèrent la défense des victimes comme étant une valeur au-dessus de toutes les autres.
Le concept de bouc émissaire s'applique-t-il dans la présente crise? Ici, on est loin du mécanisme immémorial par lequel une foule se réconcilie miraculeusement en se liguant contre une victime, loin aussi de l'immolation pieuse et bien organisée d'une victime sacrée. En effet, M. Hubaud prend la défense des agences de notation en nous rappelant que les banques sont également coupables. Cela monte à deux le nombre de boucs émissaires, ce qui n'assure pas l'unanimité et donc le bon fonctionnement du mécanisme. Sans un exutoire unique, la violence n'est pas canalisée vers l'extérieur. Le débat sur le choix des boucs émissaires devient de plus en plus âpre et se répercute sur la crise en ajoutant à la confusion...
La critique de M. Hubaud est donc loin d'être radicale et on pourrait d'ailleurs lui reprocher de frôler de près l'idée reçue. Toutefois, il est vrai que plus on en parle, moins ce mécanisme fonctionne, car pour se perpétuer il doit rester voilé par la méconnaissance. Il y a donc un principe d'incertitude associé au mécanisme victimaire : le phénomène se retire de la scène historique dans la mesure où nous arrivons à le repérer. Aujourd'hui, on a donc souvent affaire au bouc émissaire de type sous-déterminé. On se demande comment il faut parler de ces cas intermédiaires, où la violence s'ébauche mais ne cristallise pas.

Dans le New York Times du 19 août, un article sur la crise hypothécaire américaine ("In Mortage Meltdown, missed signs") m'a immédiatement fait penser au "catastrophisme éclairé" de Jean-Pierre Dupuy. Depuis le 11 septembre 2001 et à l'instar de Jonas auprès des habitants de Ninive, ce philosophe joue le rôle du prophète réticent dans une demi-douzaine de livres dont Avons-nous oublié le mal? Penser la politique après le 11 septembre (2002) et Retour de Tchernobyl, Journal d'un homme en colère (2006). Ces livres sont hantés par la question suivante: face aux crises nucléaires, écologiques, et économiques à venir, comment convaincre les gens que le principe de précaution cher aux gestionnaires de risque ne suffit pas, que la seule façon d'éviter l'impensable et de la concevoir comme certaine?
La crise hypothécaire aux Etats-Unis soulève de nouveau cette question. Si certains investisseurs l'ont prévue et en ont tiré d'immenses profits, la plupart d'entre eux n'ont pas vu venir le tsunami (" Over the last two weeks, this slowly building wave became a tsunami in the global financial markets" peut-on lire dans l'article du Times). Ce tsunami était cependant annoncé par les analystes les plus expérimentés qui savaient déjà il y a deux ans (en 2005 et 2006 lorsque le marché immobilier américain a atteint son zénith) que les prêts étaient trop risqués: "All of the old-timers knew that subprime mortgages were what we called neutron loans — they killed the people and left the houses," comme le disait un banquier de l'état de Colorado.
La voix de ces analystes s'ést élevée en vain car la catastrophe ne "se possibilise" qu'au moment où elle se produit, nous rappelle Dupuy. Elle a ceci de particulier qu'avant de se produire elle apparaît "tout à la fois comme probable et impossible" (Bergson à propos de la guerre de 1914).
Dans le schéma de Dupuy, le prophète a donc le plus grand mal à communiquer à ses auditeurs la réalité viscérale de la crise imminente. On l'entrevoit sans vraiment y croire. Saisir la dimension réelle de la crise avant qu'elle n'arrive, c'est pourtant la seule chose susceptible de détourner les gens de leur comportement habituel, celui précisément qui aboutira au "scénario du pire". L'article du Times souligne également cet aspect de prophétie ignorée : "Oddly, the credit analysts at brokerage firms now being pummeled were among the Cassandras whose warnings were not heeded." Nul n'est prophète dans son pays--ni même dans son entreprise...
Pour écrire à Trevor Merrill, suivez ce lien
22 août 2007 "La Crise hypothécaire américaine et le catastrophisme éclairé"Review article published in Lingua Romana: A journal of French, Italian, and Romanian Culture
(http://linguaromana.byu.edu/) and reproduced here with the editor's permission:
1) Posté par Kornobis le 22/8/2007 - 21h14 (répondre)
Bravo cher Trevor pour ce lien que vous faites entre cette crise et le catastrophisme éclairé mais, dans la mesure où on sait grâce à René Girard que jeter Jean-Pierre Dupuy à la mer ne fonctionnerait plus pour arrêter ce processus ;-), que faut-il proposer comme solution(s) à cette crise qui oblige les gens peu fortunés à abandonner leur maison aux banques ?
Notre société n'est-elle pas de plus en plus la société du "se soumettre ou se démettre" chère à Popilius et à son cercle?
2) Posté par Benoît Chantre le 14/9/2007 - 19h16 (répondre)
Merci, cher Trevor, pour le début de ce blog.
Nous sommes, de fait, entrés dans un moment de l'histoire où l'hypothèse girardienne s'avère de plus en plus pertinente pour comprendre les crises auxquelles nous assistons. Ta référence aux travaux de Dupuy est très intéressante, de ce point de vue. Il y a un "ne-pas-vouloir-voir la catastrophe" qui semble ne faire qu'un avec la conscience moderne, une forme de dénégation plus encore que de simple méconnaissance. Cette "courte vue" est plus effrayante encore que la méconnaissance: alors que la seconde, dans l'hypothèse de Girard, est une incapacité à reconnaître notre participation à la "mimésis universelle" (crispation individualiste), la première est un refus de reconnaître notre responsabilité dans l'advenue des catastrophes : elle s'apparente donc au nihilisme, entendu comme une forme d'individualisme radical.
Je ne peux que te recommander de te reporter sur le site du CIEPFC (ENS Rue d'Ulm), où est encore disponible un enregistrement d'un colloque sur les catastrophes où participait JP Dupuy, mais aussi A Garapon, F Gros, F Keck, F Worms et d'autres. Il y a là un foyer de questions qui sont aussi celles de notre association.
Bien à toi et à bientôt !
3) Posté par marliac le 24/5/2008 - 10h52 (répondre)
J'ai été très intéressé par le dernier bulletin de l'ARM où j'ai appris les découvetes de Gallese sur les neurones miroirs. Je vais le lire.
Stupéfait de rencontrer l'article sur l'Aikido alors que je me proposais de citer ma modeste expérience déjà ancienne et depuis abandonnée du karaté où je fus élevé au grade de ceinture noire par mon Maître (sensei) Murakami (aujourd'hui décédé) qui entre autres formation nous apprit que 'voir' l'adversaire et donc le vaincre (doucement éventuellement puisque 'voir' c'est savoir ce qu'il va faire et faire ce qui est adapté beaucoup plus vite que lui et sans effort) était l'état d'esprit auquel nous devions arriver (appuyé sur une formation physique qui associait l'âme et le corps). Mon Maître réussissait celà sans effort à tout moment et nous écrasait d'un savoir que nous admirions. Au long de ces années d'entrainement je n'ai réussi qu'une fois à aller plus vite que lui, sans vouloir aller vite.
Certains rares manuels de karaté parlent de celà sous des termes japonais : mizu no kokoro, etc..
Je vous prie de croire en mes meilleurs sentiments et meilleurs souhaits pour ARM.
Ajouter un commentaire